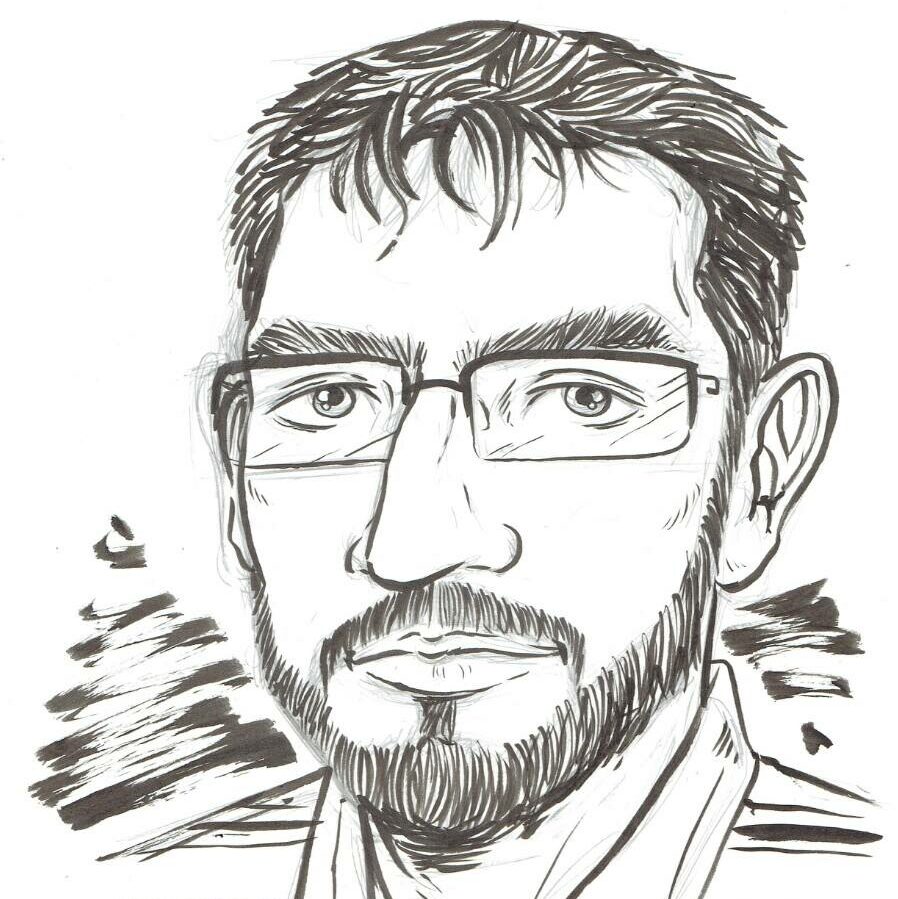Oct 8, 2006
Le retour du travail à la chaîne
Dossier centres d’appels au Maroc

Le retour du travail à la chaîne
Avec l’avènement d’une société de services, où l’industrie et le travail mécanisé décline, on avait espéré un temps que le travail serait de moins en moins répétitif. La société de services serait la société du relationnel, donc du travail humanisé. Mais les prévisions optimistes faites par les économistes il y a quelques années ont du plomb dans l’aile. Car si les centres d’appels sont l’exemple même de l’essor des services dans l’économie, ils n’en sont pas moins des exemples de néo-taylorisme.
L’organisation du travail, caractérisée par la recherche de la rentabilité optimale, favorise des conditions de travail éprouvantes. Mehdi H, 23 ans, téléconseiller pour un opérateur téléphonique, témoigne : « Le travail est si prenant que le soir, je n’ai plus envie de faire quoi que ce soit« . Les horaires l’expliquent en grande partie : généralement six jours sur sept de travail, à raison de journées de 9h. Mais le décalage horaire avec la France, principal pays partenaire, justifie que de nombreux Marocains commencent leur journée de travail dès 6h du matin. Ces horaires contraignantes sont le principal motif de démotivation des employés. Adil M., 25 ans, et qui travaille également dans un centre d’appel à Casablanca, est nettement moins enthousiaste qu’au moment de son embauche, lorsqu’il arrivait tout droit de Oujda, il y a tout juste trois mois : « Les consultations chez le médecin, les courses, les démarches administratives, et tout simplement les loisirs, pour tout ça je n’ai plus le temps! » peste-t-il, en rajoutant « il me faut des fois prendre des congés pour aller chez le médecin« . Ceux qui quittent ces centres d’appels le font principalement pour cette raison, faute de trouver de contrat à temps partiel.
Mais outre ces semaines chargées, les employés doivent faire face à un stress permanent. Car chaque salarié est sous-évaluation permanente. Dans les centres de réception d’appels, chaque employé est susceptible de faire l’objet d’écoutes. Ces écoutes, fréquentes, contrôlent la maîtrise du français, les connaissances des scripts, la politesse, etc. Et donnent lieu à une notation, qui joue un grand rôle dans l’évolution de carrière de l’employé. Dans les centres d’émission d’appels, le système est différent, car il n’y a pas de service d’écoute. Mais le stress est peut-être plus important. En effet, ces centres sont souvent consacrés au démarchage auprès de clients européens. Dès lors, chaque vendeur est placé devant une obligation de résultat, qui impacte fortement le salaire. Ce qui devient une source de stress à part entière. Hanane, 21 ans, par exemple, démarche des particuliers en Belgique pour le compte d’une société de maquillage. Elle doit passer plus de 400 appels par jour pour réaliser tout au plus deux ou trois ventes. Un rythme rapidement décourageant. Et pourtant, Hanane doit chaque jour réaliser au moins une vente pour ne pas se voir prélever 3 heures de salaire. Une menace qui chaque jour lui fait mettre en jeu 60 dh.
Stressant également, le contrôle de l’assiduité, qui met souvent en péril l’évolution professionnelle pour le moindre retard. Les promotions se gagnent et se perdent en minutes de retard, lorsque la compétence professionnelle est sensiblement la même. De fait, il n’existe aucun moyen d’échapper à son travail et à la surveillance de la direction. Oussama, 20 ans, salarié du centre d’appel de HP à Casablanca, explique même: « Si l’on passe trop de temps à faire des manipulations sur l’ordinateur sans passer d’appels, le « team manager » nous rappelle à l’ordre. » Horaires astreignants, surveillance étroite et efforts permanents sont donc le prix à payer pour avoir un salaire relativement plus favorable que dans d’autres secteurs.
Antony Drugeon, LIBERATION, le 7 & 8 octobre 2006
More Details