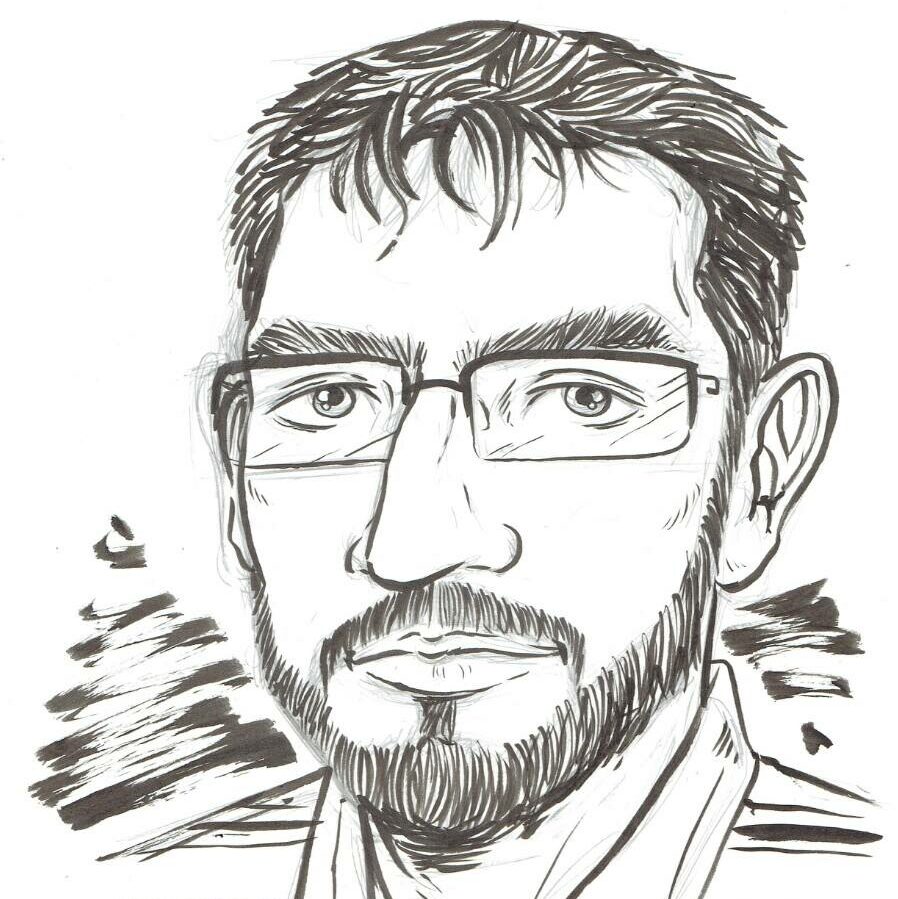Oct 23, 2008
Salman Rushdie, le conteur passionné

A l’occasion de la sortie de son nouveau livre, L’enchanteresse de Florence, l’écrivain indien Salman Rushdie était l’invité de la Fête du Livre, à Aix-en-Provence (sud de la France), du 17 au 19 octobre.
Un homme assis face à un mur d’yeux. Le regard serein et rieur à la fois, les paupières presque tombantes, Salman Rushdie fait figure de patriarche érudit. L’homme sait captiver son auditoire sans jamais se départir pour autant de sa nonchalance. Sa notoriété se charge, seule, de saisir l’attention de la foule, venue remplir l’amphithéâtre où se tient sa conférence.
Mais qui est Salman Rushdie ? Le nom de l’écrivain a beau être irrémédiablement associé à la fatwa de l’ayatollah Khomeyni, suite à la publication des Versets sataniques en 1988, il n’en reste pas moins empreint de mystère. Comme si cette publicité retentissante avait éclipsé tout le reste. Nombreux sont ceux qui voient en lui un essayiste spécialiste du blasphème, que ce soit pour l’en féliciter ou l’en blâmer. « A cause de la fatwa, beaucoup de gens m’ont pris pour un auteur religieux, ennuyeux, et incompréhensible, à l’image de ceux qui m’attaquaient » déplore l’écrivain indo-britannique, qui considère que « cette ombre portée sur mon œuvre est pire que la fatwa elle-même ».

- Salman Rushdie. Photo : Antony Drugeon (CC)
A l’occasion de la traduction en français de son dixième roman, L’enchanteresse de Florence, Salman Rushdie rappelle au lectorat francophone qu’il n’en est rien. Ce roman historique plonge le lecteur à la charnière des XVe et XVIe siècles, entre la Florence des Médicis et l’Empire Moghol où règne le puissant Akbar. Mais il est imprégné de contes d’amour, de trahison, de pouvoir, de magie et de sorcellerie, tous plus enchanteurs les uns que les autres. Le roman s’inspire ouvertement des Mille et une nuits, et entraîne le lecteur dans les histoires du narrateur, emboîtées les unes dans les autres. Le seul moyen pour cet énigmatique beau parleur de sauver sans cesse sa vie auprès de l’empereur moghol, tel Schéhérazade.
Salman Rushdie, un mystique qui s’ignore ?
L’enchanteresse de Florence mêle donc la fiction à l’Histoire. « Quelques libertés ont été prises avec l’Histoire, dans l’intérêt de la vérité », avertit, insolent, l’auteur, dès la première page. Une façon pour Salman Rushdie, natif de Bombay, de se situer au confluent de la rationalité et de l’émerveillement, de l’Occident et de l’Orient. Non pour les opposer, mais plutôt pour les faire se rencontrer. « Du fait de ma position personnelle, entre les cultures indienne et anglaise, j’ai toujours voulu écrire sur les rencontres entre des mondes différents » explique Salman Rushdie.

- Salman Rushdie. Photo : Antony Drugeon (CC)
Une rencontre physique imaginée de toute pièce pour le bienfait de l’histoire, mais qui sert de prétexte à une réelle comparaison entre les Renaissances italiennes et mogholes d’alors. « Ce qui m’intéressait dans cette époque, c’est qu’en ces deux endroits, on y assiste au développement de la valeur individuelle, à l’éloignement de l’idée de la religion et du groupe » développe l’auteur, qui se réjouit de voir « la vie sensuelle triompher dans les deux cas ». L’individualisme et l’enchantement réunis, en quelque sorte.
Salman Rushdie serait-il un mystique ? Il s’en défend, lui qui souligne « [venir] d’un pays frappé par les gourous », mais reconnaît que « l’écriture permet de combler le vide laissé par la mort de Dieu ». L’univers délirant sorti de son esprit permet, « comme la religion pour d’autres », d’approcher « cette part d’immatériel et d’irrationnel qui nous anime tous ». D’ailleurs, s’il ne goûte guère à la superstition dans la « vraie vie », il admet être particulièrement friand de « sorcellerie, de miracles et de mythologie » dans son écriture.

- Salman Rushdie. Photo : Antony Drugeon (CC)
« Franchir la ligne », tel est son leitmotiv. Car il refuse de soumettre la créativité de l’écrivain à quelque cause que ce soit. Ni la patrie, ni, bien sûr, la religion. L’auteur de Franchissez la ligne est formel : « C’est absurde de parler de responsabilité pour l’écrivain, il n’y a que l’inspiration qui compte ». C’est donc tout naturellement que Salman Rushdie soutient la publication des caricatures de Mahomet. « Il serait tout à fait inacceptable de ne pas les publier » tranche-t-il, argumentant que « répondre à la violence en se soumettant ne permet pas d’avoir la paix, il faut même les republier ! ». Celui dont la vie et l’œuvre font un pont entre l’Orient et l’Occident n’ignore pas que nombreux sont ceux qui « rejettent le mélange des cultures, l’enrichissement mutuel », mais il leur signale qu’ils ne pourront pas « uniformiser le monde » et leur conseille donc de faire avec. Un simple conseil de patriarche, pas une fatwa.
Antony Drugeon, le 23 octobre 2008
Salman Rushdie, L’enchanteresse de Florence, 2008, éditions Plon.
More Details