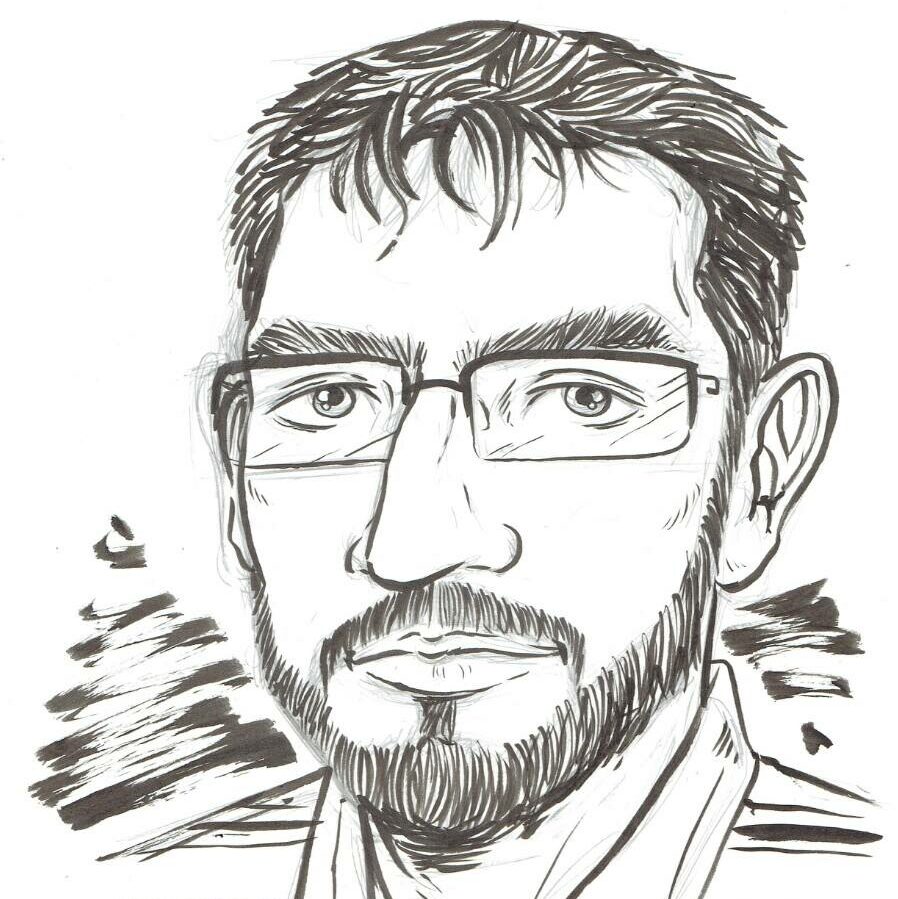Oct 27, 2008
Quand la diplomatie du makrout pédale dans la semoule

La nourriture marocaine serait-elle en passe de perdre son rayonnement international ? Plongée dans le secteur alimentaire marocain d’Aix-en-Provence, en France.
« Vous représentez le Maroc mieux que moi » aurait reconnu M. Sijilmassi, l’ambassadeur du Maroc en France, après un repas au Riad, l’un des restaurants marocains les plus renommés d’Aix-en-Provence (sud de la France), s’adressant à son propriétaire. C’est du moins ce que se plaît à raconter celui-ci, Ali Az-Ziani, avec une fierté très peu contenue. Et force est de constater que les premiers ambassadeurs du royaume chérifien à l’étranger sont les restaurateurs et les pâtissiers marocains. En effet, en France, la nourriture et la décoration orientale sont généralement qualifiées de marocaines, au point que Sabine Calstier, gérante du magasin d’ameublement et décoration syro-libanais Au pays des merveilles, à Aix, s’en exaspère. « Les clients se disent toujours pouvoir trouver moins cher en allant au Maroc ! » explique cette commerçante positionnée sur le haut standing et le design dernier cri.
A la pâtisserie marocaine Mosaïque, dans la rue Van Loo, la popularité du Maroc auprès des Français confine même à la ferveur. Dans un local étroit mais propre, aux murs carrelés de motifs traditionnels marocains, une vitrine impeccable abrite diverses assiettes recouvertes de cellophane. Cornes de gazelle, chabakias, khmissettes, mchweks, baklavas et montecaos s’y laissent admirer en ordre de bataille. Un grand plat contient msemmens, baghrirs et autres pastillas. Installée derrière sa table en fer forgé, son verre de thé à la menthe à la main, Jacqueline, 59 ans, se rêve propriétaire des lieux : « Bonjour ! » lance-t-elle aux clients qui entrent. Cette habituée ne tarit pas d’éloges sur la maison et ses pâtisseries, qui « ne sont pas du tout dégoulinantes de miel comme se l’imaginent la plupart des gens ».
Une réputation imméritée ?
Cependant le Maroc jouit d’une renommée qui le dépasse désormais. En effet, les produits marocains sont loin de se tailler la part du lion dans les épiceries orientales. Ali Az-Ziani, également propriétaire de la pâtisserie Mosaïque, confie : « Pour les matières premières, nous nous fournissons auprès d’un grossiste turc qui fait autorité sur le secteur ; il n’y a pas d’équivalent marocain, car le Maroc ne fait rien pour se mettre en valeur ». Et de pester contre les autorités marocaines, qui n’apportent « aucune aide, mais au contraire qui cassent les pieds à la douane ». L’épicerie orientale la plus fréquentée d’Aix-en-Provence est vraisemblablement La corbeille d’Orient, rue des Cordeliers. Le son de cloche n’y est pas plus encourageant. Entre les grands sacs de semoule, les odorants bocaux de raisins secs, le savon noir, les falafels et le boulghour, son gérant, M. Charkrajian, explique que ses produits proviennent de nombreux pays, mais que le Maroc n’y joue qu’un faible rôle. En effet, la production chérifienne s’y résume aux dattes, lorsque c’est la saison, et… au vin. Même le safran provient d’Iran.

Le rayonnement international du Maroc reposerait donc sur Boulaouane, mais aussi sur la harira. Laquelle est en effet produite à El Jadida par Maggi, du groupe suisse Nestlé, mais simplement pour que celui-ci aie le droit d’utiliser l’appellation « harira ». Un sombre tableau que ne rejette pas Gilles Guillem. Ce marchand d’olives depuis 22 ans tient un étal sur le marché du boulevard de l’Europe, presque exclusivement dédié aux olives. Celles-ci proviennent toutes du Maroc, « parce qu’il y a une vraie diversité là-bas » explique-t-il. Tout en réajustant l’écriteau « olives mixtes à la harissa du Maroc », il ajoute « ce n’est pas comme ici en Provence, que les gens persistent à percevoir comme le pays de l’olive ». Pourtant, poursuit-il, « le Maroc ne fait rien pour encourager les exportations, il n’est là que empocher des tarifs douaniers très élevés ». Quelques étals plus loin, Cyrille Giudalia, 32 ans, se veut encore plus alarmiste. Derrière ses sachets de ras el hanout, cet épicier spécialisé en produits orientaux importés explique d’abord que « les personnes âgées, qui ont le temps de cuisiner, sont ravies de découvrir les saveurs du Maghreb ». Mais, du fait de cette demande, les supermarchés commencent à sentir l’émergence d’un marché nouveau. Ceux-ci produisent désormais eux-mêmes ces produits, avec une qualité parfois inégale, et vendraient à perte, spécialement pour Noël et le Ramadan. « Notre chiffre d’affaire, normalement élevé à ces périodes, a été divisé par deux » déplore-t-il. Les exportateurs marocains apprécieront.
Antony Drugeon, LE JOURNAL HEBDOMADAIRE, le 25 octobre 2008
More Details