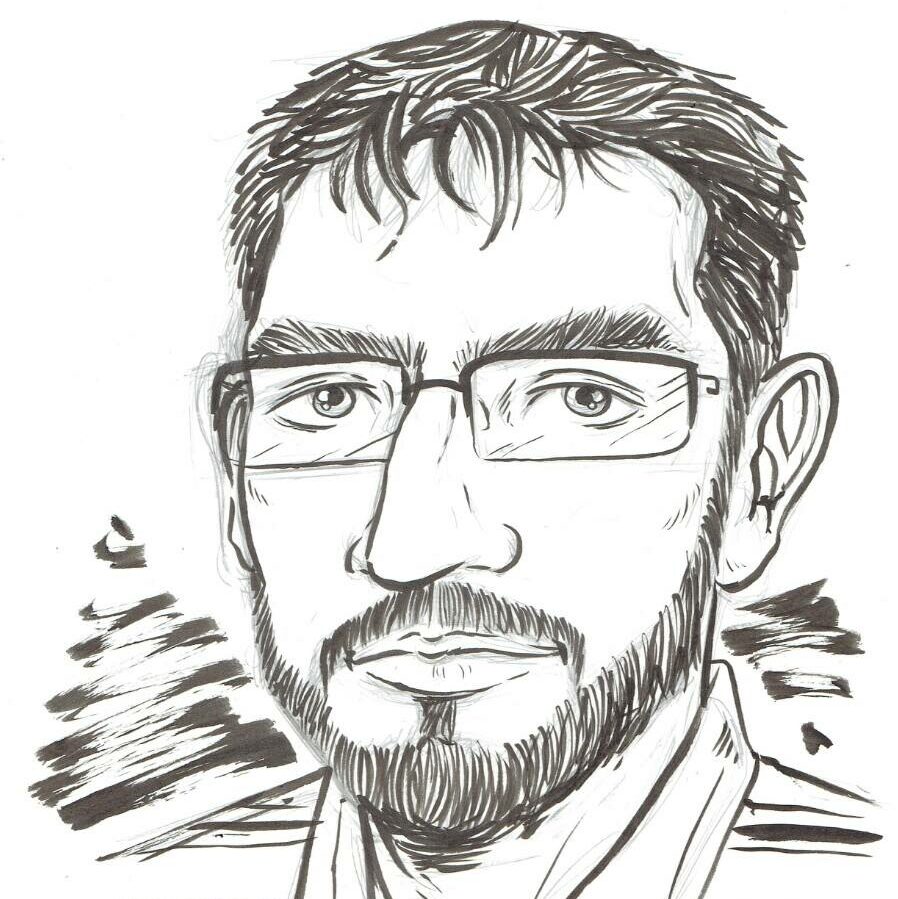Oct 24, 2006
Les prisons affichent complet

Un rapport de l’Observatoire marocain des prisons pointe du doigt les conditions de vie en prison.
Sans créer la surprise, cette publication remet d’actualité la question des conditions de vie en prison. Les pénitenciers, arrivés à saturation, offrent des conditions de vie qui « ne répondent pas aux besoins de la vie digne« , avait déclaré notamment Mohamed Abdennabaoui, directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. Il avait proposé en juillet un programme de construction d’établissements pénitentiaires offrant les conditions normales de la vie et les normes de dignité (infirmerie, hygiène, propreté, prévention) et dotés des sites d’activité pour l’éducation et la formation des prisonniers. Mais le problème principal des prisons marocaines est le surpeuplement, la capacité actuelle d’hébergement ne suffisant qu’à la moitié des effectifs.
« Les établissements pénitentiaires reçoivent plus que le double de leur capacité d’hébergement supposée« , a affirmé jeudi le président de l’Observatoire, Abderrahim Jamaï, dans une conférence de presse pour la présentation du rapport annuel de son institution, même si l’Observatoire admet qu’il y a eu des effets positifs de l’augmentation du nombre des établissements pénitentiaires. La surpopulation a des « conséquences graves » sur la vie dans l’espace carcéral, en ce sens qu’elle favorise la promiscuité et la violence et gêne grandement les fonctionnaires dans l’accomplissement de leur mission d’encadrement des prisonniers, explique M. Jamaï.
Le rapport fait état d' »insuffisances de services« , particulièrement en matière d’hygiène personnelle, d’alimentation, d’enseignement, de formation professionnelle et de soins de santé. Le rapport propose plusieurs recommandations pour l’amélioration de la situation dans les prisons marocaines, notamment « la nécessité urgente d’harmoniser la législation marocaine avec les conventions internationales des droits humains, particulièrement en ce qui concerne les conditions minimales de traitement des détenus« .
L’Observatoire se prononce en outre pour l’abolition de la peine de mort, et dénonce des entorses au principe de non-discrimination entre les prisonniers. Il relève même que la loi marocaine ne s’applique pas systématiquement dans les établissements, d’où certaines dérives. Ce qui renvoit alors à un problème de transparence : difficile de connaître ces dérives de l’extérieur. C’est pourquoi l’Observatoire a également suggéré que les ONG puissent accéder aux prisons, et que les commissions de surveillance des prisons puissent faire leur travail sans entrave. Les prisons demeurent en effet particulièrement inaccessibles aux militants des droits de l’homme et aux journalistes, avec toutes les interrogations que cela suscite en terme de respect des droits élémentaires.
Quoiqu’il en soit, le problème du surpeuplement dans les prisons est un secret de Polichinelle, et à cet égard les propositions de l’Observatoire marocain des prisons coïncident avec celles de M. Abdennabaoui : promotion des peines alternatives et des peines assorties de sursis. Enfin, pour rendre le travail des personnels moins pénibles, l’Observatoire propose l’amélioration des conditions morales et matérielles des fonctionnaires, l’augmentation des budgets des établissements pénitentiaires et la mise sur pied, à l’intention de la population carcérale, de programmes « réguliers et permanents » d’éducation et de loisirs. L’Observatoire marocain des prisons est une organisation non-gouvernementale (ONG) fondée en 1999 par des militants des droits de l’homme. Cette institution se fixe pour objectif de protéger les droits des détenus à travers la surveillance de la situation dans les établissements pénitentiaires au Maroc.
Antony Drugeon, LIBERATION, 23 & 24 octobre 2006
More Details