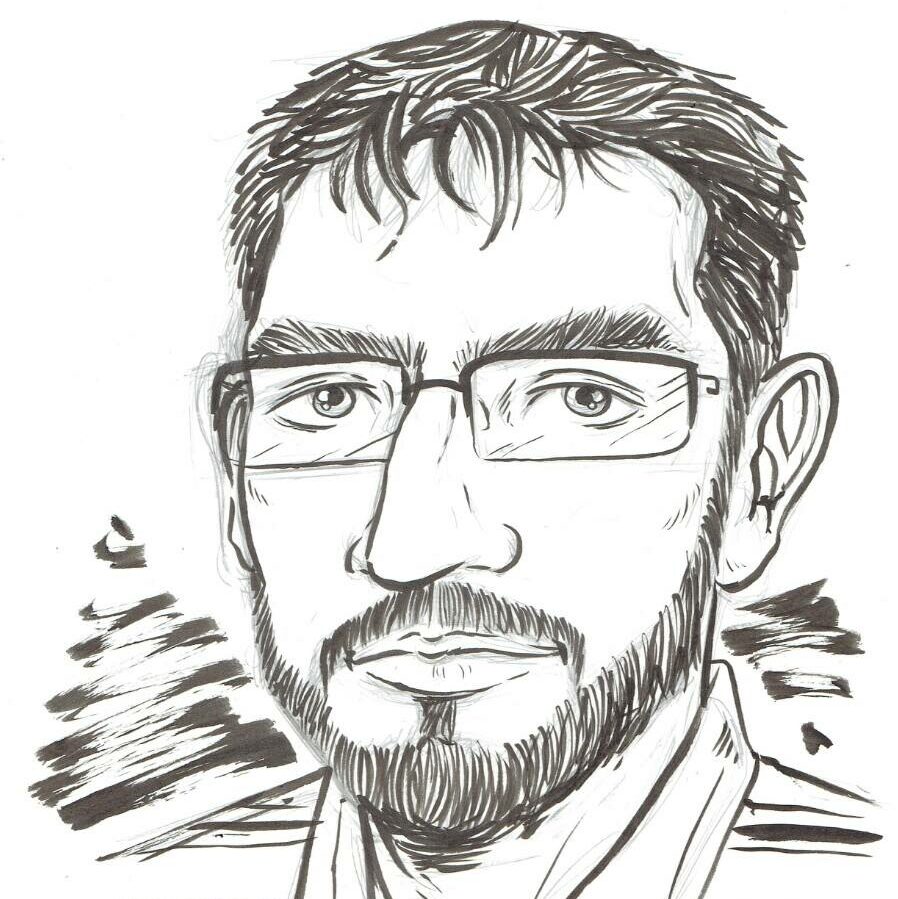Jan 16, 2009
Quand Marseille défile pour Gaza

Un peu partout en France, le samedi 10 janvier a pris les couleurs palestiniennes. Plongée au cœur de la manifestation marseillaise pour Gaza.
14h30, porte d’Aix, à Marseille. Le grouillement, habituel à ce croisement à deux pas du très populaire marché du soleil, a quelque chose de plus « figé ».Deux camionnettes, des hauts parleurs, une banderole et des drapeaux rappellent aux passants que la journée est celle de la grande manifestation marseillaise en solidarité avec Gaza. En ce jour, Marseille tente de réitérer et d’amplifier la manifestation du samedi précédent.
Les Marseillais, mi passifs, mi mobilisés, se toisent. Les passants marchent d’un pas quelquefois pressé ; parfois ils s’arrêtent, et lancent des regards à la fois curieux et emphatiques, face à la forêt de drapeaux rouges, noirs, blanc et verts [les couleurs du drapeau palestinien, NDLR] qui s’agitent. Mais les deux Marseille, mobile pour l’une, mobilisée pour l’autre, se côtoient sans se parler. Un passant crie « Israël criminel !» en se glissant furtivement le long de la foule en formation, sans se détourner de son chemin. Une mère, portant le hijab, dans le cortège naissant, affiche pro-palestinienne à la main, s’exclame, amère : « On dit pas ça comme ça, pour rigoler ! », les sourcils froncés. Sa fille, 7 ans, drapée dans un drapeau palestinien, reprend, joyeuse : « Israël criminel ! ». La mère se retourne, interloquée.

Ambivalente, duale, Marseille le demeure en toute occasion. Les banderoles et les slogans étaient précisément l’occasion d’exprimer cette dualité. Le cortège ne s’est pas encore mis en marche qu’une discussion vive oppose un homme, dont la pancarte arbore une étoile de David et une croix gammée, reliées par un signe égal. Une femme s’adresse à l’homme sur un ton conciliant, mais ferme : « Il ne faut pas faire cet amalgame !.. Tous les Juifs ne sont pas d’accord avec ce qui ce passe ». L’homme, visiblement agacé d’être sermonné, concède en maugréant chercher un marqueur pour rajouter les deux traits « pour faire le drapeau israélien, alors ». Avant de se sauver plus loin, dans la marée humaine, d’où jaillissent quelques drapeaux irakiens, libanais, et mille pancartes, en plus des drapeaux palestiniens.
Mme Njeim, de son nom, « patrouille » en effet parmi la foule, à la traque des banderoles litigieuses. « Je suis mariée à un Palestinien, et je devais venir ici », explique cette Française dans la quarantaine, pour manifester mais aussi « ne serait-ce que pour calmer le jeu, ce que je ne suis pas la seule à faire d’ailleurs, beaucoup de Marseillais, musulmans, font aussi ce travail », souligne-t-elle. Mi rationnelle, mi virevoltée, Marseille a donc vu son cortège s’ébranler peu après 15h.
Les organisateurs s’en étaient tenus à des mots d’ordre mesurés, « excluant le mot Hamas, mais insistant sur la participation du peuple marseillais, sans référence religieuse », explique Mustapha, 50 ans, la voix éraillée après avoir scandé au micro, une demi-heure durant, les motifs légitimant la manifestation.
Au cri de « Gaza debout, jamais à genoux ! », « Nous sommes tous des Palestiniens ! », « Israël assassin ! », les manifestants, estimés à 20.000 personnes selon les organisateurs, à 4.500 selon la police, ont descendu le boulevard des Dames pour rallier le boulevard de la République, jusqu’au Vieux Port, avant de s’engouffrer dans la rue du Paradis, qui abrite le consulat israélien. Toutefois l’accès à celui-ci était empêché par les CRS qui bloquaient la rue, poussant le défilé à rejoindre la préfecture toute proche. C’est là que les manifestants se sont progressivement dispersés, dans le calme.
Le calme, c’était précisément l’obsession des organisateurs, soucieux de ne pas voir les plus excités décrédibiliser tout le mouvement. Un souci partagé par les manifestants les plus anonymes. Ainsi, alors que de nombreux commerçants baissaient le rideau de fer de leur boutique, dans la rue de Paradis, la tension a, l’espace d’un instant, monté, lorsque des jeunes ont couverts de huées les clients huppés sortant des boutiques chics encore ouvertes. « Dans ce quartier ce sont tous des Juifs ! » lance un jeune homme, tentant de pardonner l’ambiance, prompte aux débordements. Mais ceux-ci n’ont jamais vraiment éclaté, grâce à la vigilance des manifestants les plus âgés, qui par exemple jetèrent leurs regards foudroyants sur un jeune de 13 ans qui tapait du poing un rideau de fer, avant que de fermes « Non ! » ne montent spontanément à l’attention du gamin. Fausse alerte.
La manifestation n’aura pas démentie les critiques de ceux qui font de cette mobilisation un phénomène communautaire, qui touche quasi-exclusivement les Arabes. De fait, une très large majorité de manifestants étaient Arabes ; à l’image de la ville, rétorquera-t-on. Pour Ali H., un jeune Franco-Libanais manifestant avec son drapeau jaune du Hezbollah, il faut plutôt regretter que la manifestation n’aie pas davantage d’ampleur, compte tenu des effectifs de la population arabe et musulmane dans la ville. « Finalement, à Marseille, il y a beaucoup de Français [de souche, NDLR] qui manifestent, par rapport à tout ce qu’il y a comme Arabes » déplore-t-il. Ce qui n’a nullement empêché les manifestants de crier « Allahou Akbar » avant de traiter le président égyptien Hosni Moubarak de traître, alternativement en français et en arabe, tout comme le président français Nicolas Sarkozy.

Pour Noëlle M., enseignante retraitée et grande habituée des mobilisations syndicales, c’est l’occasion de renouer avec les manifestations. « Ça faisait longtemps, raconte-t-elle, que je n’ai pas manifesté. Mais là j’ai décidé de venir, c’est important parce que j’ai peur qu’on prépare une nouvelle génération de kamikazes, j’ai peur que les choses ne virent à la guerre de religion ». La soixantaine, derrière ses lunettes, elle partage sa révolte avec Rabia Zeroual, une Franco-algérienne venue manifester avec ses amies « en tant que mère ». Sous une banderole rose et bleue où s’affiche « Maman, pourquoi la guerre ? » entre deux poupées relookées au keffieh, le poing en l’air, elle s’insurge : « Le problème c’est que dès qu’on critique Israël, on est soi-disant contre les Juifs ». Elle n’hésite pas à citer Comment le peuple juif fut inventé, de Shlomo Sand, cet ouvrage controversé en Israël pour faire du peuple juif une invention artificielle des auteurs sionistes XIXe siècle. « Le problème c’est que ce pays [Israël, NDLR] se définit sur une base ethnico-religieuse, exactement comme l’Allemagne nazie » répète-t-elle.
Inévitablement, les discussions débordent de la situation actuelle à Gaza, pour évoquer Israël en général. Les pancartes appelant au boycott d’Israël côtoient celles condamnant le blocus, la colonisation, ou associant Israël au terrorisme et aux pratiques génocidaires.
Ce sont sans doute les accents antisémites de la manifestation qui ont effrayé les partis politiques, demeurés discrets en fin de cortège, tandis que le Parti Socialiste (PS) n’a pas participé au défilé. Et de fait, si le service d’ordre a efficacement fait la police parmi les pancartes, hormis l’association fréquente entre croix gammée et étoile de David, les manifestants ont parfois du mal à distinguer Juifs et sionistes, Juifs et Israël. Devant la préfecture, Harb, une Franco-libanaise vivant en France « depuis 26 ans » se dit « déçue de [son] pays ». « J’ai honte d’avoir la nationalité française, Sarkozy est complice d’Israël ! », martèle-t-elle. « Les médias français sont tenus par les Juifs, poursuit-elle, les Juifs tiennent toutes les ficelles ! ». L’entourage exclame son accord, reprenant une idée maintes fois répétée durant le défilé par des organisateurs révoltés par la partialité des médias français, dont la télévision semble être la principale cible. Les Juifs de l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP) ne les convainquent pas : Aïcha, 37 ans, Franco-algérienne, est catégorique « Je ne crois pas qu’il puisse y avoir des Juifs honnêtes. Ils envoient tous de l’argent en Israël » affirme-t-elle, ajoutant seulement « ne pas être représentative ».

Cet amalgame, on le déplore, du côté de l’UJFP. Mais on ne s’en étonne plus : « C’est avant tout le fait du CRIF (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France) qui prétend parler au nom des Juifs, et d’Israël, qui construit non pas des colonies israéliennes, mais bel et bien des colonies juives ! » accuse Pierre Stamboul, membre du bureau national de l’UJFP. « Alors, dans ces conditions, il est inévitable que tant de gens fassent la confusion » déplore-t-il. L’association, qui existe depuis 7 ans, et revendique près de 300 militants dont 40 à Marseille, « commence, se réjouit Pierre Stamboul, à être reconnue ». L’enjeu, selon lui, est simple : « Il s’agit de défendre notre peau, parce qu’Israël voudrait nous mêler à ses crimes ».
Ni noire ni blanche, la réalité à Marseille est toujours dans le contraste. La ville prépare sa prochaine manifestation, suspendue à l’espoir d’un cessez-le-feu. Entre exaltation et sentiment du devoir civique.
Antony Drugeon, L’IMAGINERE, le 11 janvier 2009.
More Details